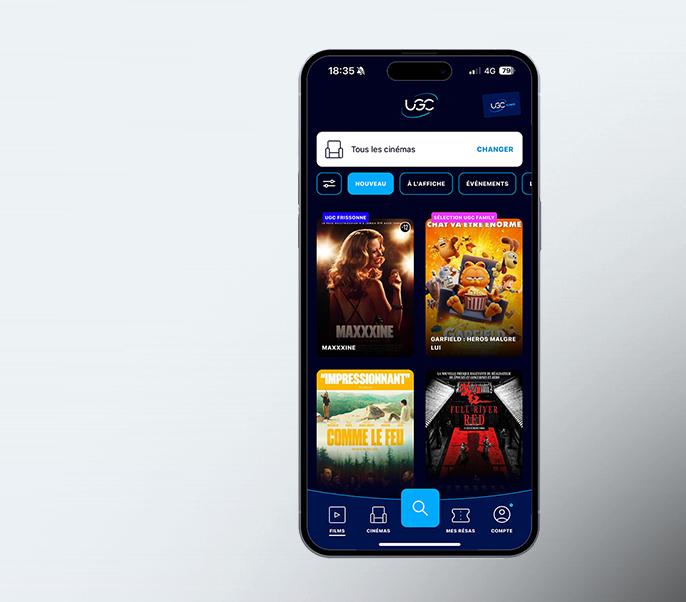WINTER BREAK D'ALEXANDER PAYNE, LE MAÎTRE DU SPLEEN AMÉRICAIN
Cinéaste libre depuis plus de 20 ans, oscarisé à deux reprises pour les scénarios de Sideways (2005) et The Descendants (2012), Alexander Payne livre cette fois une comédie mélancolique au délicieux parfum rétro. Il s’est confié sur son style d’une élégance folle, sublimé par un réel amour des personnages.
Qu’est-ce qui vous a ému dans le scénario de David Hemingson, au point de souhaiter le mettre en scène ?
Alexander Payne : Il y a 12 ans, j’ai découvert en festival le film Merlusse (1935), de Marcel Pagnol : il débute par la cohabitation forcée entre un élève et un prof tyrannique, dans un internat. Et puis David Hemingson m’a adressé le script d’un pilote de série, qui se déroulait dans cet environnement. Je lui ai demandé de s’en inspirer pour m’ écrire un long métrage. Il appréciait mes films, alors il a accepté… et gratuitement ! C’est très précieux, car cela nous a permis de garder le cap. S’il avait fallu le vendre en amont, le scénario aurait été accaparé par les financiers…
Lors d’une récente intervention au Festival Lumière, vous avez déclaré : "J’attache beaucoup d’importance aux lieux, et j’aime avoir une approche documentaire de la fiction." Qu’entendiez-vous par là ?
Je cherche constamment la "vraie" version des choses, pas leur idéalisation. Cela se traduit concrètement dans mon travail : je cherche à tourner le plus possible en décors naturels, à faire jouer des acteurs non-professionnels dans les rôles secondaires. Sur mon film Nebraska (2013), je me souviens d’avoir longtemps cherché d’authentiques agriculteurs pour entourer mes acteurs. Je pense aux films réalisés dans les années 1970, qui ont conditionné ce que je suis devenu. Autant, ils conservaient cette rigueur propre au cinéma américain, autant, ils sortaient du studio pour tourner dans la rue.
Il y a chez vous une extrême précision dans la composition du cadre, qui tranche avec ce qu’on voit aujourd’hui dans le cinéma américain.
À l’école de cinéma, mes camarades étaient obsédés par les films européens de Jean-Luc Godard, Andreï Tarkovski, Rainer W. Fassbinder, etc. Je les ai vus, mais j’étais davantage intéressé par le classicisme hollywoodien d’Ernst Lubitsch, Charlie Chaplin, Max Ophüls… Mon style visuel puise dans leur élégance, dans la manière dont ils orchestraient la caméra et les acteurs, de sorte à couper le moins possible. Pour cela, il vous faut de très bons techniciens, et des acteurs capables de mémoriser leurs dialogues. (Rires.)
On a le sentiment que vous déroulez le fil de l’intrigue au diapason de vos personnages et de leurs émotions. Comment procédez-vous ?
Quand la cuisinière est déposée par Angus devant chez sa sœur, le garçon lui dit au revoir et elle lui répond : "Hé, il faut que tu m’aides à monter !" Cet élément fait-il avancer l’histoire ? Non. Mais il contribue en revanche à l’humaniser. Il y a un court documentaire réalisé pour la revue Sight & Sound et disponible sur YouTube, "What is neorealism?", qui prend appui sur Station Terminus (1953) de Vittorio De Sica. Un film qu’il a tourné en Italie, mais produit par Hollywood. De Sica a monté sa version pour l’Italie, et les producteurs ont monté une version raccourcie pour les États-Unis. Le documentaire révèle les détails conservés par De Sica, comme ces figurants qu’il filme avec la même attention que son actrice. Tandis que le montage américain, lui, coupe dès que possible, dans un souci d’efficacité.
Cela contribue à la mélancolie qui traverse tous vos films. Pourraiton dire que vous réalisez des mélodrames, à votre manière ?
J’aime quand les masques de joie et de tristesse se confondent. Et puis la comédie est une affaire très sérieuse, qui permet de traiter les expériences les plus douloureuses avec du recul. C’est une forme de méditation : n’éprouve pas l’émotion, regardela. On la retrouve chez les Japonais : dans les livres à propos du cinéaste Yasujirō Ozu, on nous parle du mono no aware. Cela correspond pour eux à la mélancolie du temps qui passe, du passage des saisons... C’est certes triste, mais contempler une feuille qui tombe, cela a quelque chose de poétique.
Cet article est issu du Mag by UGC.
Winter Break, un film labellisé UGC Aime, à retrouver en ce moment dans nos cinémas.